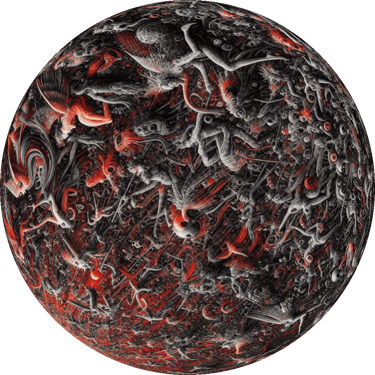Quelles alternatives à un universalisme dévoyé par les néo-croisés et les nouvelles croisades ?
L'universalisme est-il contestable uniquement parce qu'il est dévoyé ? Alors qu'il ne devrait être qu'un projet en construction permanente qui s'enrichirait de toutes les cultures humaines, il est devenu une affirmation fondée sur un dogme de l'universel humain. Il se réduit pour beaucoup à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est devenue le glaive de toutes les néo-croisades. Pourtant, l'universalisme ne peut pas être l'outil d'une propagande civilisationnelle et encore moins un prétexte à des guerres civilisationnelles.
RÉFLEXION
Frédérique DAMAI
4/1/2025


La complexité est le propre de l'humain et vouloir s'en départir conduit nécessairement à des aberrations. La Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, est fondée sur des préceptes de conception individualiste qui ne pourront jamais répondre de toutes les humanités dont l'individualisme n'est pas le cœur.
Pour animer cette discussion, nous allons partir de deux exemples qui illustrent à quel point la réduction est dangereuse et le regard sur les cultures est à géométrie variable. L'un relève de la science amusante, l'autre d'un sujet beaucoup plus sérieux.
Quand l'automatisation pose des questions à l'universalisme
Il peut paraître incongru de faire un détour vers les études sur les voitures autonomes, mais celles-ci produisent parfois des sujets de réflexion pertinents.
Dans le protocole « Moral Machine » (1) « l'objectif de l'étude est de comprendre le jugement des personnes en ce qui concerne les dilemmes moraux complexes qui impliquent des situations de vie ou de mort (à la fois dans des contextes médicaux et non médicaux). »
Cette étude internationale comporte de nombreux biais méthodologiques (seulement 10 langues, culture et moyens Internet, volontariat, etc.) mais, quoi qu'il en soit, l'analyse des réponses porte à la réflexion. On ne s'attardera donc pas sur les discussions méthodologiques, mais sur les résultats en cours qui sont riches d'interrogations.
Pourquoi ? Parce qu'ils parlent de choix factuels et spontanés qui révèlent des valeurs profondes des individus et non pas de propos discursifs qui peuvent relever de la pure rhétorique. Cette étude s'appuie sur un mode d'enquête par projection, beaucoup plus pertinent que les questionnaires explicites. On ne détaillera pas ici les conclusions actuelles qui sont disponibles par ailleurs.
Bien évidemment, les résultats laissent apparaître des choix différents dans une même culture, avec de nombreuses constantes. Mais existe-t-il des différences statistiquement significatives entre des cultures très différentes ? La réponse est oui.
Prenons un exemple. Dans la situation dans laquelle les freins de la voiture lâchent, on nous demande de choisir entre écraser un enfant ou une personne âgée, sans autre alternative. Si le sauvetage de l'enfant est choisi majoritairement en occident et particulièrement en France, le choix de sauver la personne âgée sera beaucoup plus fréquent dans d'autres cultures.
Les différences de réponses sur ces scénarios traitant de la mort, y compris au sein d'une même culture, montrent à quel point la notion d'universalisme est réductrice. Un autre scénario montre qu'entre un médecin et un sans-abri, on épargnera plutôt le médecin. Ces résultats interrogent sur le versant très théorique de l'égalité en droit de tous les êtres humains, par exemple. D'autres préféreront écraser un humain plutôt qu'un animal domestique, etc.
L'intérêt d'une telle étude n'est pas de répondre à quelque chose, outre la commande industrielle qui est faite. L'intérêt est de démontrer que l'on ne peut pas répondre universellement, justement. Elle montre l'étendue de la complexité et qu'il n'existe aucune raison qu'une réponse humaine soit avancée comme plus universelle qu'une autre. Ceux pour qui sauver un enfant plutôt qu'un vieillard est une évidence, doivent accepter de s'interroger sur la non-universalité d'une telle valeur. Car l'universalisme dogmatique est toujours fondé sur les valeurs d'un groupe, d'une culture, d'une société…
Les croisades à géométrie variable
Pourquoi les néo-croisés brandissent-ils des droits universels dans certaines situations et à l'égard de certaines civilisations et cultures et pas à l'égard de certaines autres ? Pourquoi leur mission universaliste n'est finalement pas universelle ?
Intéressons-nous un instant à ce que l'on appelle les sociétés traditionnelles ou sociétés autochtones. Aucune n'est évidemment comparable à l'autre et leurs cultures, coutumes et traditions sont uniques, et d'ailleurs la question n'est pas là.
Il existe à l'égard de ces sociétés une forme de consensus qui stipule de les respecter et de ne pas intervenir dans leur mode de vie. Ce consensus est d'ailleurs partagé, voire prôné avec force par les prosélytes habituels.
Pourquoi donc les prêcheurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme excluent-ils ces peuples ?
Parce que leurs cultures et leurs traditions sont conformes à cette déclaration des droits de l'homme ? On sait que ce n'est pas le cas pour la plupart.
Parce que cela concerne des petits nombres et que cela n'a aucune importance ? Curieux.
Parce que l'on prend conscience que ces croisades sont ridicules lorsque l'on se confronte à des cultures tellement différentes ?
Parce qu'il serait impopulaire et peu tendance de les remettre en cause ?
Parce que l'on ne confère pas le statut d'humain à ces peuples ? Si cette dernière proposition paraît odieuse, nous pensons cependant qu'elle a quelque chose de réel dans l'esprit de beaucoup.
Posée de cette manière, la question attendrait une réponse. Mais si l'on prenait le problème dans l'autre sens. Si, après tout, il était simplement fondé de respecter ces cultures ? Il serait également fondé de respecter toutes les autres cultures, y compris lorsqu'elles concernent des millions de personnes. De quoi nous mêlerions-nous à bouleverser ces cultures traditionnelles autochtones ? Si cette question est légitime ici, alors elle l'est partout ailleurs.
Quelles alternatives à cet universalisme de croisade ?
Le défi de l'universalisme est d'être un lieu de discussion permanente où l'on tente de faire émerger une perspective commune. Une première et unique marche pourrait-elle être franchie et acceptée de tous ? Proposer qu'il existe un socle commun qui soit la reconnaissance d'une identité de la communauté humaine. Ensuite, toutes les autres étapes ne pourront être qu'hypothétiques, sujets de l'échange.
Aller plus loin de façon unilatérale est contradictoire, car il ne peut y avoir d'universalisme que par le résultat de discussions et d'une construction universelle.
L'humanisme universaliste de Mario Rodríguez Cobos (dit Silo) répond-il à ces exigences de prudence ? En partie oui, et il demeure une référence dans le domaine, sur de nombreux aspects. On considérera que les concepts qu'il promeut : dignité, respect, tolérance, égalité, non-violence... sont des hypothèses pouvant servir de plateforme de dialogue. Attention cependant à ce que cela ne devienne pas des dogmes, par inadvertance. L'importance qui est attribuée au dialogue entre les cultures pour favoriser la tolérance et la compréhension mutuelle est rassurante de ce point de vue. Nous restons un peu plus circonspects sur le poids qui est accordé à l'individu et à ses évolutions personnelles. La place de l'individu n'est pas centrale dans un grand nombre de cultures. Donner une telle importance à l'individuel revient à franchir une étape qui, déjà, ne nous paraît pas universelle. Toutefois, les valeurs d'humanité qui animent cette proposition alternative, ainsi que les nombreuses initiatives qui en sont nées, méritent que l'on y accorde beaucoup d'intérêt et de respect.
Le pluriversalisme. Pour faire simple, disons qu'il est une réaction aux dérives de l'universalisme et de ceux qui cherchent à prescrire des valeurs occidentales à l'ensemble des cultures. Ce mouvement vient aussi bien de penseurs, comme certains anthropologues ou philosophes, que de revendications de peuples considérant leur culture exclue de cet universaliste rétréci. Plutôt qu'un universalisme dominant, il vise à défendre un monde multiple où des valeurs coexistent sans qu'aucune ne prétende s'imposer aux autres. Ce qui n'empêche pas de dialoguer et de chercher à élaborer des ponts plutôt que des murs.
Les critiques de ces alternatives
Les critiques dont sont régulièrement la cible ces alternatives tiennent en réalité à ce qu'elles ne soient pas intégrables aux logiques d'échange qui prédominent les relations inter-sociétales. Nous aborderons largement ce champ dans un article consacré aux pactes, traités et autres alliances. Mais pour résumer, disons que dans le grand schéma des échanges internationaux (commerciaux, militaires, culturels, touristiques…), on a fini par inclure les valeurs dans ces modalités d'échange. Malheureusement, les valeurs sont devenues un objet comme un autre et non plus un sujet de dialogue. Et comme tous les autres objets d'échanges, les valeurs sont gérées par une logique de compétition, de domination et de prosélytisme comminatoire et parfois violent.
Est-ce parce que les sociétés autochtones ne sont pas incluses dans ces processus d'échanges que l'on respecte leurs cultures ?
Une des critiques constantes concerne la question de l'échange sur les valeurs et la possibilité de promouvoir ses propres valeurs. Ces alternatives véhiculent l'image d'un relativisme passif et indifférent. Bien sûr, personne ne peut interdire à quiconque de croire en ses propres valeurs et d'avoir envie de les partager : la question n'est pas là. Mais la meilleure valorisation que l'on puisse avoir de ses propres valeurs est de se les appliquer à soi-même. C'est l'application factuelle des valeurs que nous défendons en occident qui séduira peut-être d'autres cultures : uniquement par l'exemple. Ni contraintes, ni escrotique (marketing et promotion publicitaire de ces valeurs).
Si nous dépensions la moitié d'autant, que ce que nous dépensons à dicter nos valeurs aux autres, à tenter de réaliser une société qui ressemble un peu aux valeurs que nous promouvons, il est possible que d'autres soient séduits.
Si l'Occident veut définitivement croire, pour lui, à l'universalité de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il en a parfaitement le droit. En revanche, cela ne lui donne aucun droit de l'imposer aux autres. Et quitte à dépenser de l'énergie, on aimerait alors plus d'initiatives permettant de l'appliquer dans son intégralité, ici même. Cela, bien évidemment, dans tous ses aspects, y compris dans son versant social et dans les pratiques non-violentes et pacifistes que cette déclaration implique.
Frédérique DAMAI, auteur de « Nowar, 47 jours d'espoir », Éditions L'Harmattan
Image : Craiyon.com
(1) https://www.moralmachine.net/hl/fr. Etude proposée par Internet dans 233 pays par le Massachusetts Institute of Technology d'Harvard, l'Université de la Colombie-Britannique au Canada et la Toulouse School of Economics de Toulouse. Plus de deux millions de personnes ont déjà participé à cette étude.